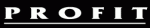◊ A propos de la série télévisée culte «Profit»
"The important thing to remember in business is that what may seem like a calamity may turn out to be an opportunity" (Jim Profit).
 La télévision n’aime pas le monde des affaires. Rares sont les séries ou les feuilletons à succès ayant élu pour thème majeur la finance ou le monde du travail*. Et lorsque c’est exceptionnellement le cas (Working ou Murphy Brown par exemple), l’univers décrit est toujours plus ou moins lié à Hollywood : les intrigues louvoient entre médias, cinéma et édition, censés représenter le summum du glamour pour les scénaristes de télévision [1].
La télévision n’aime pas le monde des affaires. Rares sont les séries ou les feuilletons à succès ayant élu pour thème majeur la finance ou le monde du travail*. Et lorsque c’est exceptionnellement le cas (Working ou Murphy Brown par exemple), l’univers décrit est toujours plus ou moins lié à Hollywood : les intrigues louvoient entre médias, cinéma et édition, censés représenter le summum du glamour pour les scénaristes de télévision [1].
Exception de taille à cette règle artistique : Profit, une série atypique et dérangeante diffusée pour la première fois sur le réseau de la Fox en 1996 et reprise en France par la chaîne thématique Canal Jimmy. Cette production, devenue «culte» pour les passionnés de créations télévisuelles, fait de l’intrigue financière un art obscur et ésotérique. Et son héros, Jim Profit, un manipulateur si machiavélique qu’à ses côtés, le J.R Ewing de Dallas et le Gordon Gekko de Wall Street font figure d’aimables rentiers. Pour le télespectateur perplexe, regarder Profit est une expérience particulière qui s’apparente à observer de près un piranha en pleine action dans un aquarium...
American psycho
Mais qui est Jim Profit? Un jeune cadre ambitieux, fraîchement recruté par une multinationale fictive, Gracen & Gracen, dont l’activité consiste pour l’essentiel à racheter d’autres sociétés. Nous faisons la connaissance de Profit lors des funérailles de celui qu’il s’apprête à remplacer comme adjoint au Département des Acquisitions.
Est-il responsable de ce décès ? Nous ne le saurons pas mais, d’emblée, il trouve le moyen de faire chanter une secrétaire de direction et de commencer à fomenter son ascension inexorable dans la société. Dans les épisodes suivants, il gravira l’échelle des promotions sans le moindre scrupule, allant jusqu’à provoquer la mort de ceux qui le gênent.
 Expert en psychologie, Profit excelle à manipuler ses collègues de bureau, tirant profit (le sens de son patronyme est très vite clair pour tout le monde) de la moindre faiblesse.
Expert en psychologie, Profit excelle à manipuler ses collègues de bureau, tirant profit (le sens de son patronyme est très vite clair pour tout le monde) de la moindre faiblesse.
Il est également un «maître du cyberespace» ce qui signifie qu’il a accès aux données confidentielles de n’importe qui, depuis ses relevés bancaires jusqu’à ses radiographies dentaires. Profit passe d’ailleurs une bonne partie des épisodes dans une pièce secrète de son appartement, assis nu devant l’écran de son ordinateur, parcourant le monde virtuel en quête de la moindre information.
Box office
La nuit, enfin, Profit a pour habitude de dormir dans un carton, replié dans une position fœtale. Cette étrangeté, que n’aurait pas renié le David Lynch de Twin Peaks, est l’une des particularités de la série.  En effet, si Jim Profit ressemble comme un clone à ces cadres aux dents longues aperçus ici et là aux détours de films souvent caricaturaux, un point le distingue de ses confrères : ses motivations dépassent la simple cupidité et révèlent un traumatisme profondément enfoui. En effet, après que ses parents ont divorcé, son père l’a élevé... dans un carton ! Le jeune Profit devait même s’y nourrir et n’en sortait qu’une fois par semaine pour une toilette sommaire. Seule compensation paternelle : une petite ouverture dans le carton, à travers laquelle le reclus pouvait regarder la télévision. Dans ces conditions, on comprend le comportement quelque peu asocial de ce «héros» que son interprète, Adrian Pasdar, décrit en ces termes : «Je ne pense pas que Profit soit dépourvu de morale, il a juste pris un avion différent du nôtre».
En effet, si Jim Profit ressemble comme un clone à ces cadres aux dents longues aperçus ici et là aux détours de films souvent caricaturaux, un point le distingue de ses confrères : ses motivations dépassent la simple cupidité et révèlent un traumatisme profondément enfoui. En effet, après que ses parents ont divorcé, son père l’a élevé... dans un carton ! Le jeune Profit devait même s’y nourrir et n’en sortait qu’une fois par semaine pour une toilette sommaire. Seule compensation paternelle : une petite ouverture dans le carton, à travers laquelle le reclus pouvait regarder la télévision. Dans ces conditions, on comprend le comportement quelque peu asocial de ce «héros» que son interprète, Adrian Pasdar, décrit en ces termes : «Je ne pense pas que Profit soit dépourvu de morale, il a juste pris un avion différent du nôtre».
Style abstrait
Certes, aucun feuilleton n’avait jamais mis en vedette un anti-héros qui dort nu dans un carton après avoir passé sa journée à comploter et poignarder dans le dos ses collègues de bureau.
Est-ce là la principale originalité de ce feuilleton très spécial ? Non, d’autant que le reflet qui est donné du monde des affaires n’est pas non plus révolutionnaire.
 Nous sommes loin d’un Wall Street qui démontait les mécanismes des prises de capital et de leurs conséquences sociales désastreuses. Les créateurs de Profit ont fait de leur mieux pour structurer le feuilleton comme un drame aux résonances mythologiques. L’action se déroule dans une cité sans nom couleur de muraille [2]. Les opérations de Gracen & Gracen, «la compagnie de la famille» demeurent pour le moins nébuleuses, pour ne pas dire abstraites. Tout au plus saura-t-on que la compagnie pratique des acquisitions (sociétés, information et sans doute les âmes de ses employés...), ce qui l’élève, avec un capital de 14,5 milliards de dollars au quinzième rang mondial.
Nous sommes loin d’un Wall Street qui démontait les mécanismes des prises de capital et de leurs conséquences sociales désastreuses. Les créateurs de Profit ont fait de leur mieux pour structurer le feuilleton comme un drame aux résonances mythologiques. L’action se déroule dans une cité sans nom couleur de muraille [2]. Les opérations de Gracen & Gracen, «la compagnie de la famille» demeurent pour le moins nébuleuses, pour ne pas dire abstraites. Tout au plus saura-t-on que la compagnie pratique des acquisitions (sociétés, information et sans doute les âmes de ses employés...), ce qui l’élève, avec un capital de 14,5 milliards de dollars au quinzième rang mondial.
Quant au héros au nom d’emprunt symbolique [3], il agit, supprime obstacles et adversaires sans que son but soit en définitive très clair. Tandis qu’il affirme de plus en plus sa volonté de tout contrôler, Profit semble obsédé par quelque chose qui dépasse de loin ce que le poste de PDG pourrait lui prodiguer.
 Déshumanisé, vierge de la moindre émotion qui viendrait entraver la bonne marche de ses malversations, il se comporte en véritable machine à comploter. Petit frère du Patrick Bateman d’American Psycho, cousin germain du personnage joué par Demi Moore dans le film Harcèlement, Profit a pour modus operandi de récolter le plus d’informations sur tout le monde afin d’utiliser chaque faiblesse à son profit. Ses talents de pirate informatique sont cruciaux pour la réussite de ses plans et c’est d’ailleurs lorsqu’il est assis seul chez lui, à jouer sur son ordinateur à déplacer les personnes comme des pièces d’échecs qu’il semble le plus «vivant».
Déshumanisé, vierge de la moindre émotion qui viendrait entraver la bonne marche de ses malversations, il se comporte en véritable machine à comploter. Petit frère du Patrick Bateman d’American Psycho, cousin germain du personnage joué par Demi Moore dans le film Harcèlement, Profit a pour modus operandi de récolter le plus d’informations sur tout le monde afin d’utiliser chaque faiblesse à son profit. Ses talents de pirate informatique sont cruciaux pour la réussite de ses plans et c’est d’ailleurs lorsqu’il est assis seul chez lui, à jouer sur son ordinateur à déplacer les personnes comme des pièces d’échecs qu’il semble le plus «vivant».
Un autre point qui l’humanise en partie, c’est sa capacité à échouer. De quoi désorienter quelque peu un public habitué à voir ses héros triompher à la fin de chaque épisode. Profit, lui, passe par des hauts et des bas. Il conclut la plupart des épisodes par de petites remarques telles que «Well, we won» ou «Gosh, better luck next week»...
Autrement dit, en dépit de quelques détails inédits, rien de foncièrement original dans le portrait de ce yuppie psychopathe prêt à tout pour gagner le pouvoir.
Hollywood vs. business
Plus intéressante, en revanche, est la perpétuation, à travers la série, d’une vision négative du commerce et de l’économie.  Faire d’un financier le méchant de l’histoire n’est guère nouveau, mais le lancement de Profit a ravivé la vieille querelle sur le traitement du monde des affaires par Hollywood, résumée dans cette formule lapidaire : «the greedy scoundrels are getting what they deserve» (les gredins cupides ont ce qu’ils méritent). Pour Alan Merten, doyen de la Cornell University's Johnson Graduate School of Management, c’est en partie la faute des hommes d’affaires eux-mêmes qui ont mal géré, à partir des années 80, la concomittance de vagues de licenciement avec l’attribution de primes et de stock-options juteux.
Faire d’un financier le méchant de l’histoire n’est guère nouveau, mais le lancement de Profit a ravivé la vieille querelle sur le traitement du monde des affaires par Hollywood, résumée dans cette formule lapidaire : «the greedy scoundrels are getting what they deserve» (les gredins cupides ont ce qu’ils méritent). Pour Alan Merten, doyen de la Cornell University's Johnson Graduate School of Management, c’est en partie la faute des hommes d’affaires eux-mêmes qui ont mal géré, à partir des années 80, la concomittance de vagues de licenciement avec l’attribution de primes et de stock-options juteux.
Mais l’acrimonie hollywoodienne n’est pas une mode, c’est une institution. Déjà, en 1992, les hommes d’affaires représentaient 43 % des criminels dans les programmes de divertissement, loin devant les avocats, les politiciens ou toute autre profession [4]. A croire que les scénaristes de télévision demeurent fidèles à une idéologie qui ne peut concevoir les affaires comme une activité honorable destiné à procurer à la société des biens, des services, de la richesse et des emplois.
De nos jours, notamment aux Etats-Unis, le PDG est perçu par l’ensemble des employés comme une personne omnipotente et intouchable. Impossible de critiquer, de parler, même à la presse, sous peine de perdre sa place. Aussi comment le public ne s’intéresserait-il pas à un feuilleton qui se contente de dire «oui, ça se passe exactement comme ça»?
Alors que ceux qui sont insatisfaits de leur travail sont légion à et hors Hollywood, les scénaristes trouvent motivant de développer des intrigues où l’on puisse, par procuration, renverser la hiérarchie et écraser son supérieur, quitte même à recevoir une augmentation au passage...
Freud est-il capitaliste ?
En fin de compte, ce qui distingue réellement Profit des autres séries télévisées, c’est la formidable fusion réalisée entre d’une part, le monde matérialiste représenté par le monde de la finance et d’autre part, le pathos du personnage principal, dont les motivations, sans être réellement explicitées, trouvent de lointains éléments de réponse dans le passé...
Dans l’un des épisodes les plus étonnants, le spectateur découvre en effet la source de l’obsession du personnage principal. Certes, il a été élevé dans un carton, ce qui en soi constitue déjà un motif sérieux d’inadaptation sociale, mais sur ce carton était imprimé... «Gracen & Gracen, The Family Company». Autrement dit, Jim Profit, en grimpant les échelons de la hiérarchie par tous les moyens, ne fait rien d’autre que de ... rentrer chez lui ! Et lorsqu’il se confie à nous, de sa voix râpeuse et envoûtante, lorsqu’il croise notre regard depuis le fond de son carton, il prouve à quel point il est facile de modeler des individus selon des normes et des idées préfabriquées.
Paradoxalement, Profit est un show télévisé qui s’inscrit dans un mouvement de refus du petit écran : non seulement dénonce-t-il le vide abyssal de l’éthique de l’Amérique des affaires, mais il tire à boulets rouge sur la génération qui va en hériter, une génération élevée devant le poste de télévision et qui en a embrassé les valeurs.
Ce message fut peu, ou pas, compris du public. Malgré des critiques louangeuses et le soutien d’un petit noyau de passionnés, la série fut interrompue après moins de dix épisodes, officiellement en raison d’une faible audience [5]. Cet échec souligne le genre de loi d’airain que même Profit n’aurait pas osé enfreindre : les bonnes critiques sont rassurantes, mais rien ne vaut de confortables recettes publicitaires...
Jean-Michel OULLION
----------------------------------------------------
* Depuis la rédaction de cet article, paru en 2000 dans la revue La Voix du Regard (n°13), ce n'est plus tout à fait vrai, avec la diffusion de séries comme The Office ou Caméra Café.
[1] Sans parler des commissariats, tribunaux, prisons et autres cabinets d’avocats indispensables aux séries policières.
[2] Profit a été tourné à Vancouver, comme la plupart des épisodes des X-Files.
[3] Le télespectateur apprend très vite que Profit n’est pas son vrai nom, la quête de l’identité réelle du héros est d’ailleurs l’un des ressorts dramatiques de la série.
[4] Source : Media Research Center study of entertainment programming.
[5] Pourtant, des séries avec des audiences similaires ont connu des existences moins brèves. Certaines rumeurs sur Internet ont suggéré que la Fox de Rupert Murdoch a peut-être mis fin à la série car elle décrivait un monde des affaires rappelant trop son propre empire.